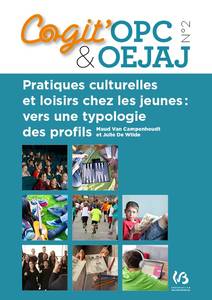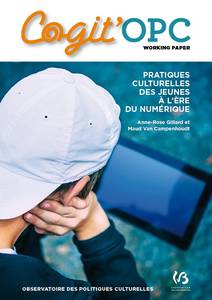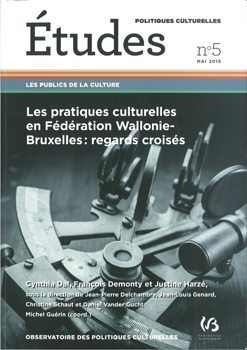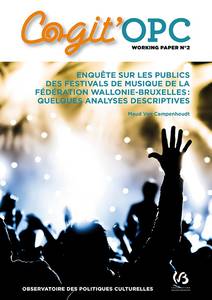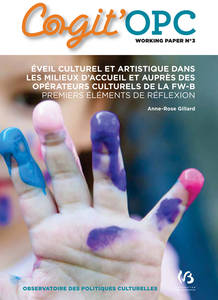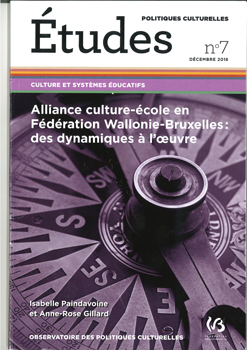Études réalisées

Les pratiques culturelles des personnes d'origine étrangère de première et deuxième génération résidant en FW-B
 |
L'Observatoire a lancé, en 2019, une enquête sur les pratiques culturelles et les loisirs des personnes d'origine étrangère de "première et deuxième générations". Cet article présente les premiers résultats de cette étude. Plus précisément, il est construit autour de deux points : dans un premier temps, nous y exposons les questions que nous nous sommes posées autour de la méthodologie de l’enquête, les choix effectués, les difficultés rencontrées et les limites de notre approche. Cette partie est suivie d’une présentation de la méthodologie de l’enquête. Dans un second temps, nous présentons des analyses descriptives portant sur les activités de l'ensemble des participants à l'étude et nous confrontons une série de résultats aux données issues de l’enquête générale menée en FW-B (OPC, 2017) sur la participation culturelle des personnes résidant en FW-B en comparant les activités des 16-40 ans d'origine étrangère de "première et deuxième générations" et celles des 16-40 ans belges depuis trois générations ou plus.
Les pratiques culturelles et loisirs des jeunes (5-6 primaire et 3-4 secondaire) scolarisés en FW-B
Cette publication a pour objectif de présenter une typologie de différents profils de jeunes en matière de pratiques culturelles et de loisirs. S'appuyant sur l'analyse de données récoltées auprès de 1263 jeunes de 5e-6e primaire et de 3e-4e secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles (2017-2018), les chercheuses de l'Observatoire et de l'OEJAJ identifient et décrivent six groupes distincts sur base de leurs pratiques : les connectés à tendance sociale, les connectés à tendance ludique, les éclectiques, les peu impliqués, les investis non connectés, et les investis.
Cet article permet de mettre en lumière un enchevêtrement de facteurs qui jouent un rôle dans les pratiques et goûts des jeunes en matière de loisirs et de culture, tels que l'âge, le sexe, le niveau socioculturel/socioéconomique ou encore la façon dont certaines activités sont (ou non) pratiquées et/ou discutées avec des proches (parents, fratrie, amis).
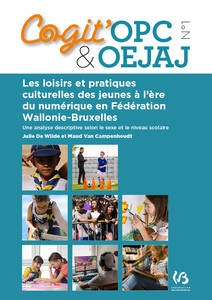 |
Les Observatoires (OEJAJ-OPC) publient conjointement un article reprenant l’analyse descriptive des résultats de cette enquête selon le sexe et le niveau d’étude des répondants. Il s’agit donc de se demander si les pratiques culturelles numériques/non numériques des jeunes sont différentes selon que l’on soit une fille ou un garçon, et selon la tranche d’âge dans laquelle on se situe.
On y retrouve notamment les observations suivantes :
- les enfants de 5e et 6e primaire ont davantage de pratiques que les jeunes de 3e-4e secondaire parmi celles qui ont été investiguées, à quelques exceptions près, liées à des pratiques « plus numériques » nécessitant notamment des équipements particuliers (partage de photos/vidéos sur internet, commentaires et informations sur des blogs/forums/Facebook, etc). On note par ailleurs un taux d’équipement plus important chez les plus âgés (GSM, ordinateur personnel, etc.) ;
- si les plus jeunes enfants fréquentent davantage les musées/expositions, spectacles, et bibliothèques, les plus âgés sont plus nombreux à évoquer les sorties au cinéma. Ces derniers passent également plus de temps à l’extérieur de chez eux pour flâner, discuter, jouer… ;
- une plus grande proportion des filles, par rapport aux garçons, fréquentent les bibliothèques, les spectacles et les concerts. Ce constat ne concerne par contre pas la fréquentation des musées/expositions, ou encore les sorties au cinéma, pour lesquelles on ne note pas de différence significative selon le sexe ;
- les filles affichent un partage plus important de photos et vidéos sur Internet par rapport aux garçons et une utilisation plus importante des tablettes/iPad et ordinateurs. Les garçons se démarquent par rapport aux filles sur les pratiques liées aux jeux vidéo, mais également au niveau du sport et des sorties en dehors de chez soi pour jouer, flâner, discuter, etc. ;
- etc.
Les pratiques culturelles des adultes résidant en FW-B
Cet article vise à vérifier si le niveau de diplôme des parents est associé à la fréquentation de certains lieux culturels (concerts, musées, spectacles, etc.), de manière différente, chez les garçons/hommes et chez les filles/femmes. Les analyses sont effectuées sur deux bases de données datant de 2017 : l’une portant sur des jeunes de 5e-6e primaire et 3e-4e secondaire et l’autre portant sur des adultes (dès 16 ans). Nous pouvons ainsi observer ce phénomène selon l’âge des répondants, même si bien sûr nous n’avons pas affaire ici à des données longitudinales.
Nous souhaitons, dans ce Cogit’OPC, présenter, à partir des données de l’enquête de 2017 sur les pratiques culturelles des adultes, des analyses portant sur les liens (analyses descriptives) entre capital culturel/économique des individus et fréquentation de certains lieux culturels (bibliothèque, cinéma, musées, sites et monuments historiques et théâtre), ainsi que des analyses de l’influence (analyses multivariées) de certaines variables relatives au capital culturel ou au capital économique (après contrôle du sexe et de l’âge) des individus sur la fréquentation de ces lieux culturels.
En 2007, l’Observatoire a réalisé une enquête sur les pratiques culturelles et les loisirs des habitants de la FW-B. À partir de cette enquête, l’Observatoire a construit, en 2012, une typologie des habitants de la FW-B sur base de leurs pratiques et goûts culturels. Cette typologie dégageait 7 types de profils. En 2017, soit 10 ans après la première récolte des données, nous avons relancé cette enquête et procédé au même type d’analyses. Les objectifs de cet article sont doubles. D’une part, nous souhaitons voir si des choses ont bougé, changé en 10 ans. D’autre part, certaines catégories dégagées en 2012 nous posaient question et méritaient d'être reconsidérées à l'aide de nouvelles analyses.
Dans notre “Études n°8” (Van Campenhoudt, Guérin, 2020), nous avons explicité, à l’aide d’analyses descriptives des données recueillies en 2017 (enquête sur les pratiques et les loisirs des habitants de la FW-B), que les pratiques culturelles, les loisirs sont, en général, liés au niveau d’instruction, à l’âge et au sexe des individus. Au niveau de l’âge, nous avons constaté qu’un bon nombre d’activités extérieures diminuent avec l’âge (fréquentation des restaurants, participation à une manifestation, fréquentation des concerts de musique pop, rock, folk ou jazz, etc.).
Lors de la présentation de nos résultats dans divers colloques et conférences, plusieurs opérateurs culturels (musées, théâtres, etc.) nous ont alors partagé leurs questionnements par rapport à ces résultats relatifs à l’âge. Selon eux, il est difficile d’attirer les catégories les plus jeunes vers les institutions culturelles.
La présente publication a pour objectif de développer des analyses plus précises en termes d’âge et de fréquentation des institutions culturelles, afin d’y voir plus clair sur cette thématique et d’objectiver ou non les ressentis de terrain.
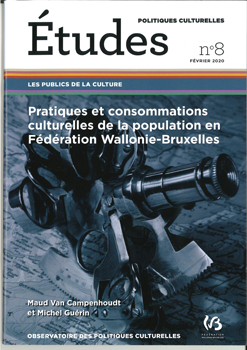 |
En 2007, l’Observatoire a réalisé une enquête générale sur les pratiques et consommations culturelles de la population en FW-B. Plus de vingt ans séparaient cette enquête de la toute première conduite en 1985. Les résultats de 2007 ont fait l’objet de plusieurs publications descriptives et analytiques (Guérin, 2009 ; Callier, Hanquinet, Genard, Guérin, 2012). Cette enquête avait également été suivie d’une étude qualitative (Dal, Demonty, Harzé, Delchambre, Genard, Schaut, Vander Gucht, 2015) qui avait pour objectif d’identifier les facteurs qui amènent les personnes à participer à une activité culturelle. Il s’agissait notamment de mettre à jour les motivations, intérêts et bénéfices tirés de cette participation et de saisir les influences et les déclencheurs qui amènent à la pratique culturelle.
En 2017, soit 10 ans plus tard, l’Observatoire renouvelle les données d’enquête pour prendre la mesure des évolutions et des changements dans les pratiques culturelles. Cette publication s’inscrit dans cette lignée, engrangeant progressivement les enseignements tirés de ces travaux.
L’approche qualitative des pratiques culturelles de la population, préconisée dès 2006 dans les premiers travaux de l’Observatoire, était envisagée comme un vis-à-vis indispensable à l’enquête quantitative qui a été menée en 2008. En effet, si cette dernière nous propose une représentation statistique générale caractérisant la distribution sociale et spatiale des pratiques culturelles, elle reste cependant muette sur le sens que les individus donnent à leurs pratiques. Cette étude vient dès lors compléter notre regard, cherchant à identifier les différents facteurs qui amènent les personnes à participer à une activité culturelle. Il s’agissait notamment de mettre à jour les motivations, intérêts et bénéfices tirés de cette participation, de saisir les influences (famille, école, groupe de pairs…) ou les déclencheurs qui amènent à la pratique culturelle et, de manière plus globale, de situer ces pratiques dans le cadre de vie plus général des individus, soit leur vie privée, familiale, professionnelle ou sociale.
Cette publication fait suite à l’étude générale sur les pratiques et consommation culturelles publiée dans le « Courrier hebdomadaire du CRISP» en 2009. Elle présente la synthèse d’une étude approfondie des données quantitatives et s’attache à déterminer les éléments qui influencent ces pratiques. Dans le prolongement de l’étude précédente, ces dernières ne se limitent pas aux pratiques culturelles qualifiées de « légitimes » mais s'étendent à l’ensemble des activités et goûts communs qui façonnent notre quotidien.
L’approche analytique, développée au travers de douze indicateurs synthétiques et d’une typologie de sept classes de profils de pratiques et consommation culturelles, met à jour plusieurs constats significatifs. D’une part, la « non-participation » qui caractérise près de 40% de la population, cette non-participation se mesurant à la fois dans l’activité culturelle et dans la vie sociale. D’autre part, l’âge et le niveau d’éducation apparaissent comme les éléments les plus importants pour déterminer la pratique culturelle : effets de génération et ressources symboliques se conjuguent pour accentuer la différentiation de manière positive ou négative. En troisième lieu, sur le plan spatial, se dégage de plus en plus l’émergence d’une culture urbaine qui distingue les grandes villes des autres territoires.
 |
|
L'Observatoire présente les principaux résultats d’une enquête générale sur les pratiques et la consommation culturelles en Communauté française réalisée en 2007. Cette enquête permet des comparaisons avec une étude du même type datant de 1985. Il est donc possible de dresser un portrait transversal, homogène et évolutif du consommateur culturel francophone.
L’enquête fait le point sur la démocratisation de la culture, l’un des objectifs majeurs des politiques culturelles. Mais les loisirs intègrent une multitude d’activités qui débordent l’offre publique et la culture « cultivée ». C’est pourquoi l’enquête prend aussi en compte l’ensemble des autres activités du temps choisi telles que la pratique d’un sport, les sorties entre amis, les promenades en famille ou encore la pratique de la messagerie instantanée sur internet".
Voir aussi la revue "Faits et gestes" :
En réponse à un appel d'offre lancé par l'Observatoire, cette étude dresse un bilan critique des données quantitatives et qualitatives relatives aux pratiques et consommations culturelles en Communauté française. Cette approche est complétée par un commentaire synthétique des principaux modèles d'interprétation des pratiques culturelles identifiés dans la littérature scientifique. Les auteurs concluent l'étude par un certain nombre de recommandations visant à déterminer les caractéristiques d'une future enquête générale sur les pratiques et consommations culturelles de la population francophone en Communauté française.
Cette recherche dirigée par Frédéric Moens (FUCAM_IHECS) a été menée par :
Le Groupe de Recherche Sociologique-Action-Sens (GReSAS),
Les Facultés universitaires catholiques de Mons (FUCaM)
Le Centre de Sociologique de l'Education, Université libre de Bruxelles (ULB)
IHECS Formation, Institut des hautes Etudes des Communications sociales,
Haute Ecole Galilée (Département social)
Les publics des festivals de musique de la FW-B
Après avoir contribué en 2013 à l’analyse des dynamiques d’organisation des festivals en Europe avec ses partenaires européens et québécois, il ressortait des entretiens avec les organisateurs de festivals en FW-B, qu’il manquait de données sur les publics des festivals. En 2016, l’Observatoire décidait d’initier une enquête auprès des festivaliers en poursuivant principalement les deux objectifs suivants :
- tester un dispositif d’enquête en ligne en associant les organisateurs à sa distribution. Sur base des données recueillies et entretiens réalisés dans le cadre de l’étude de 2013, un échantillon de 27 festivals (Rock-Pop, Classiques, Jazz et Musiques du Monde) a été sollicité, suscitant une participation à l’enquête de 2703 festivaliers ;
- analyser les comportements des festivaliers (dépenses, mobilité, nombre de concerts écoutés, etc.) ainsi que recueillir les appréciations et avis des festivaliers sur plusieurs dimensions de l’événement tels que l’aménagement du site, l’ambiance générale, la qualité des concerts, etc.
Autres études
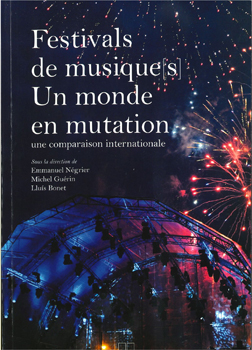 |
À l’occasion de rencontres sur les publics de la culture à l’échelle européenne, l’Observatoire s’est associé en 2011 avec les Universités de Montpellier et de Barcelone pour réaliser une vaste étude, coordonnée par « France Festivals », portant sur les festivals de musiques en Europe. À la demande de « Festival van Vlaanderen », l’Observatoire a réalisé l’étude pour une vingtaine de festivals situés en Flandre et 52 festivals ont été enquêtés en FW-B. Sur le plan scientifique et en coordination avec les Universités de Montpellier et de Barcelone, l’Observatoire a coordonné et traité les données fournies par une douzaine de pays, soit 390 festivals en Europe et au Québec. Au-delà de sa dimension scientifique inédite, cette étude se présente comme un outil d’analyse pour les festivals de musique eux-mêmes, pour les réseaux nationaux et internationaux de festivals, ainsi que pour leurs partenaires publics et privés. Un colloque international, organisé durant 3 jours à Lille, Courtrai et Tournai en novembre 2013, a accueilli plus de 300 participants et une quarantaine d’intervenants issus d’une dizaine de pays participants.
Les musées et leurs visiteurs en Communauté française (pdf)
Le présent article s’appuie sur la littérature récente pour présenter une connaissance actuelle des relations entre les musées en Communauté française et le public, que celui-ci les fréquente ou non.
Participation culturelle
L’OPC a déjà mené plusieurs recherches relatives à l’accessibilité à la culture. En 2020 nous avons publié un état de la littérature relatif à l’éveil culturel et artistique des tout-petits (pdf). Dans la présente publication, nous avons souhaité, au travers d’une enquête quantitative, nous intéresser aux modalités qui entourent cet éveil, en interrogeant aussi bien le monde culturel et artistique que le monde de la petite enfance.
Le but de cette enquête n’est pas de chercher à définir la notion d’éveil culturel et artistique mais bien de dresser un état des lieux des pratiques liées à cet éveil, dont l’objectif est de mettre en relief ce qui se joue sur le territoire belge francophone.
La récolte des données a eu lieu durant le premier semestre 2022 et à l’issue de celle-ci nous totalisons 1.238 répondants, dont 62% proviennent du monde culturel et artistique et 38% du monde de la petite enfance.
L’OPC a développé depuis quelques années déjà un domaine de recherche dédié à la culture et aux systèmes éducatifs. A cet égard, l’OPC a décidé, dès 2021, de concevoir un outil d’observation de ce parcours. Dans un premier temps, et sur base des contenus des plans de pilotage des établissements scolaires, l’Observatoire a structuré un projet de grille de suivi basé sur les trois composantes du PECA : connaître, pratiquer et rencontrer. Le projet de grille a alors été confié à l’INAS (UMONS) afin d’être testé durant l’année 2022 auprès d’un échantillon représentatif d’établissements scolaires de l’enseignement fondamental en FW-B. Comme son nom l’indique, cette grille de suivi n’a pas été conçue dans une perspective d’évaluation du PECA. Son objectif consiste en la collecte organisée et pérenne d’informations destinées à renseigner, tant sur les contenus que sur la forme, en ce qui concerne les déploiements des partenariats et partant, les choix culturels et artistiques des établissements scolaires belges francophones.
En février 2022, l’Observatoire a lancé, en partenariat avec la Chambre des Écoles supérieures des arts au sein de l’Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES), et l’Administration générale de la Culture, une enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B) sortis entre 2013 et 2020. Cette enquête par questionnaire (en ligne) vise à découvrir les "trajets d’insertion professionnelle" des diplômés (à partir de 2013) des Ecoles Supérieures des Arts, en savoir plus sur les débouchés professionnels (artistiques ou non), les éléments facilitant l’entrée sur le marché du travail, les freins à l’emploi artistique, les éléments à améliorer au niveau des études supérieures pour faciliter l’entrée dans le monde du travail, etc. Dans cette étude, la notion d’ "emploi artistique" est prise dans un sens élargi et regroupe donc des activités très diverses telles que des prestations, des projets, des contrats, activités free-lance, expositions dans une galerie, etc.
Ce 3ème numéro de Cogit’OPC se penche sur les activités d’éveil culturel et artistique à destination de la petite enfance en FW-B. Sous forme d’une revue de la littérature, le texte se concentre sur les travaux produits en Belgique francophone, sans écarter les apports d’auteurs étrangers. Il recense les contributions de spécialistes provenant d’horizons diversifiés, issus du monde de la recherche, du monde associatif ou encore de la sphère politique, en regroupant les propos des acteurs culturels et des professionnels de la petite enfance.
Les activités d’éveil culturel et artistique s’ancrent dans des fondements juridiques relatifs au “droit à la culture” (en termes d’accès, de participation à la vie culturelle…), et elles traversent nombre d’enjeux démocratiques, mais aussi sociaux, éducatifs voire économiques et de santé publique.
Par la formalisation des premiers éléments structurants pour le lancement d’un chantier de recherche, c’est sur cet état de la littérature que s’appuie le volet quantitatif de l’étude dédiée à l’éveil culturel et artistique de la petite enfance en FW-B.
L’Observatoire a lancé en 2018 une vaste enquête administrée, par voie électronique, à 1.842 opérateurs culturels et 2.648 établissements scolaires.
L’objectif de cette enquête, conçue à la croisée du monde de la culture et du monde scolaire, est de récolter des données chiffrées sur l’existence et les modalités de développement, pendant le temps scolaire, du lien entre la culture et l’école en FW-B.
Quelles sont les modalités de cette mise en œuvre ? Les obstacles rencontrés ?
Quels sont les lieux fréquentés ? Les disciplines explorées ?...
Par cette enquête, l’Observatoire entend fournir les premiers éléments de connaissance quantitatifs de situations éprouvées par les opérateurs culturels et enseignants impliqués dans le lien qu’ils développent dans le cadre scolaire.
 |
La seconde recherche, réalisée à l’Observatoire et intitulée « Les carnets d’observation artistes-enseignants : analyse » rend compte, quant à elle, des effets attendus et observés par les artistes et les enseignants sur les élèves, sur la classe et plus globalement sur l’établissement scolaire dans son ensemble.
La première publication, intitulée « Évaluation participative », est une analyse réunissant des artistes et enseignants impliqués dans le dispositif « Artistes à l’école ».
Réalisée par le réseau MAG, à la demande de l’Observatoire des politiques culturelles, en septembre 2016, elle identifie, entre autres, les tensions, les enjeux, mais aussi les freins et les leviers inhérents à l’expérience culturelle et artistique en milieu scolaire.