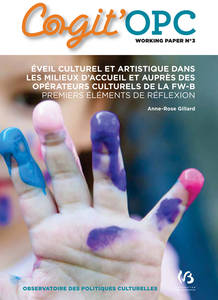2020

 |
Cycle de quatre séminaires sur la question du développement des statistiques culturelles en FW-B
Si l’Observatoire n’a pas pour vocation de produire de la statistique culturelle, (cette fonction est, jusqu’à présent confiée à l’ETNIC), bon nombre de ses travaux nécessitent cependant le recours aux données chiffrées pour construire une représentation des secteurs et matières culturelles. Il importe donc que des données soient collectées, stockées, historicisées et publiées. La question des données « utiles » à l’observation et à l’analyse des politiques culturelles avait déjà fait l’objet d’une première étude, en 2002, sur les systèmes d’information relatifs aux opérateurs subventionnés et développés par les services de la Direction générale de la culture. En conclusion de ce travail, un certain nombre de recommandations avaient été formulées et concernaient notamment le statut des opérateurs, les flux financiers et l’emploi, les activités ainsi que la mesure de la participation des populations. Dans son dernier rapport d’activités (mai 2014), l’Observatoire recommandait qu’une politique coordonnée soit instaurée en matière d’information et de statistiques relatives aux politiques culturelles. Ces recommandations ont, par ailleurs, été reprises dans le Contrat d’Administration.
Pour mettre concrètement en œuvre ces recommandations, l’Administration générale de la culture (AGC) et l’Observatoire des politiques culturelles (OPC) ont signé fin janvier 2017 un protocole de collaboration et de partenariat en matière de conception et de construction d’un système d’information coordonné relatif aux politiques culturelles. Cette convention porte sur la mise en œuvre progressive d’une coordination opérationnelle entre l’OPC et les différents services de l’AGC en matière de conception et de construction de référentiels, d’outils et de données statistiques relatifs aux politiques culturelles.
Cette coordination porte notamment sur les objets suivants : les typologies (des politiques culturelles, des opérateurs culturels, des instruments de politique culturelle), le thésaurus des politiques culturelles, les législations, réglementations et autres normes de politique culturelle, les données relatives au budget administré par l’AGC et à son affectation entre les différentes politiques, les données relatives aux infrastructures culturelles de la FW-B, les bilans et procès-verbaux des organes d’avis et de concertation, l’inventaire (annuel) des opérateurs culturels subventionnés, les données relatives au budget administré par l’AGC et de son affectation entre les opérateurs subventionnés, les données relatives à l’organisation des services administratifs en charge de la Culture, les données d’information comptables des opérateurs culturels subventionnés, les données relatives aux activités des opérateurs culturels subventionnés, les données relatives aux publics, à la participation des populations, et aux conditions d’accès (cibles, tarifs,…) et les données relatives à l’emploi des opérateurs culturels subventionnés.
De manière à soutenir la coopération décrite dans cette convention, l’AGC et l’OPC ont décidé d’organiser en 2017 et 2018 un cycle de quatre séminaires sur la question du développement des statistiques culturelles en FW-B.
Ces séminaires porteront successivement sur : 1° la mesure des pratiques culturelles et de la participation sociale à la culture, 2° les dépenses et le financement culturels, 3° les indicateurs économiques et la mesure de l’emploi, 4° le périmètre du champ culturel.
Ce cycle de séminaires s’articule autour de trois questions centrales qui en dessinent l’horizon de référence :
Quelles représentations du monde sont véhiculées par les choix méthodologiques en matière de statistiques culturelles ?
Quelles sont les pistes concrètes pour dépasser les obstacles et difficultés actuelles ?
En quoi les données collectées peuvent-elles être utiles aux opérateurs et aux usagers ?
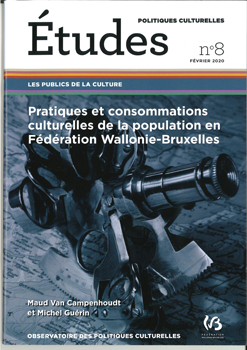 |
En 2007, l’Observatoire a réalisé une enquête générale sur les pratiques et consommations culturelles de la population en FW-B. Plus de vingt ans séparaient cette enquête de la toute première conduite en 1985. Les résultats de 2007 ont fait l’objet de plusieurs publications descriptives et analytiques (Guérin, 2009 ; Callier, Hanquinet, Genard, Guérin, 2012). Cette enquête avait également été suivie d’une étude qualitative (Dal, Demonty, Harzé, Delchambre, Genard, Schaut, Vander Gucht, 2015) qui avait pour objectif d’identifier les facteurs qui amènent les personnes à participer à une activité culturelle. Il s’agissait notamment de mettre à jour les motivations, intérêts et bénéfices tirés de cette participation et de saisir les influences et les déclencheurs qui amènent à la pratique culturelle.
En 2017, soit 10 ans plus tard, l’Observatoire renouvelle les données d’enquête pour prendre la mesure des évolutions et des changements dans les pratiques culturelles. Cette publication s’inscrit dans cette lignée, engrangeant progressivement les enseignements tirés de ces travaux.
L'Observatoire s'est étroitement associé à la démarche initée par le Service général du Pilotage et de Coordination des Politiques transversales du Secrétariat Général de la FW-B qui a lancé, en juin 2020, une enquête auprès du secteur associatif.
Il s'agit d'une enquête transversale touchant plusieurs domaines de compétences de le la FW-B, dont le secteur culturel, et réalisée auprès des responsables opérationnels des associations agréées/reconnus par la FW-B ou bénéficiaires d'une convention pluriannuelle ou d'un contrat programme de la FW-B. La réalisation de l'enquête a été confiée à la Direction de la Recherche du Secrétariat général de la FW-B.
La présente publication est dédiée aux résultats pour le secteur culturel, dont l'analyse a été réalisée par l'Observatoire. L'objectif était d'établir un premier état des lieux sur la manière dont les organisations et les équipes qui les font vivre ont géré cette période particulière.
En 2007, l’Observatoire a réalisé une enquête sur les pratiques culturelles et les loisirs des habitants de la FW-B. À partir de cette enquête, l’Observatoire a construit, en 2012, une typologie des habitants de la FW-B sur base de leurs pratiques et goûts culturels. Cette typologie dégageait 7 types de profils. En 2017, soit 10 ans après la première récolte des données, nous avons relancé cette enquête et procédé au même type d’analyses. Les objectifs de cet article sont doubles. D’une part, nous souhaitons voir si des choses ont bougé, changé en 10 ans. D’autre part, certaines catégories dégagées en 2012 nous posaient question et méritaient d'être reconsidérées à l'aide de nouvelles analyses.
Dans notre “Études n°8” (Van Campenhoudt, Guérin, 2020), nous avons explicité, à l’aide d’analyses descriptives des données recueillies en 2017 (enquête sur les pratiques et les loisirs des habitants de la FW-B), que les pratiques culturelles, les loisirs sont, en général, liés au niveau d’instruction, à l’âge et au sexe des individus. Au niveau de l’âge, nous avons constaté qu’un bon nombre d’activités extérieures diminuent avec l’âge (fréquentation des restaurants, participation à une manifestation, fréquentation des concerts de musique pop, rock, folk ou jazz, etc.).
Lors de la présentation de nos résultats dans divers colloques et conférences, plusieurs opérateurs culturels (musées, théâtres, etc.) nous ont alors partagé leurs questionnements par rapport à ces résultats relatifs à l’âge. Selon eux, il est difficile d’attirer les catégories les plus jeunes vers les institutions culturelles.
La présente publication a pour objectif de développer des analyses plus précises en termes d’âge et de fréquentation des institutions culturelles, afin d’y voir plus clair sur cette thématique et d’objectiver ou non les ressentis de terrain.
En 2019, l’Observatoire a accompagné l’agence Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse (WBTD) dans une démarche d’enquête auprès d’artistes et de compagnies de la FW-B qui, durant la période 2016-2017 (période de référence choisie volontairement plus ancienne afin de permettre le temps de création et de diffusion des spectacles), ont bénéficié d’un soutien de la FW-B sous une des formes suivantes (libellé différent selon les secteurs culturels) : contrat-programme, convention, aide ponctuelle, aide à la création, aide au projet, aide au projet pluriannuelle. Et ce, dans les secteurs culturels suivants : cirque/arts de la rue, danse, jeune public, théâtre, interdisciplinaire.
L’objectif était, d’une part, de faire un état des lieux de leur diffusion internationale, en 2018 et, d’autre part, de récolter de l’information afin d’aider, a posteriori, ces artistes/compagnies dans l’amélioration de leur diffusion à l’étranger.
L’enquête s’est déroulée entre juin 2019 et octobre 2019 auprès des 215 cibles qui ont pu être identifiées par les services de l’Administration générale de la Culture auxquels WBTD a fait appel.
Ce 3ème numéro de Cogit’OPC se penche sur les activités d’éveil culturel et artistique à destination de la petite enfance en FW-B. Sous forme d’une revue de la littérature, le texte se concentre sur les travaux produits en Belgique francophone, sans écarter les apports d’auteurs étrangers. Il recense les contributions de spécialistes provenant d’horizons diversifiés, issus du monde de la recherche, du monde associatif ou encore de la sphère politique, en regroupant les propos des acteurs culturels et des professionnels de la petite enfance.
Les activités d’éveil culturel et artistique s’ancrent dans des fondements juridiques relatifs au “droit à la culture” (en termes d’accès, de participation à la vie culturelle…), et elles traversent nombre d’enjeux démocratiques, mais aussi sociaux, éducatifs voire économiques et de santé publique.
Par la formalisation des premiers éléments structurants pour le lancement d’un chantier de recherche, c’est sur cet état de la littérature que s’appuie le volet quantitatif de l’étude dédiée à l’éveil culturel et artistique de la petite enfance en FW-B.
Notre nouvelle collection « OPC Ph.D. Review », dédiée au soutien à la recherche doctorale, s’ouvre avec la contribution d’Anne-Sophie Radermecker - première candidate à avoir remporté le Prix du mémoire de l’OPC (en 2012) et première lauréate du Soutien à la recherche doctorale (en 2016) à avoir défendu sa thèse - : "La valeur marchande du nom d'artiste : une étude empirique sur le marché (1946-2015) des tableaux flamands anciens, avec implications pour le secteur muséal".